XVIIe siècle
-
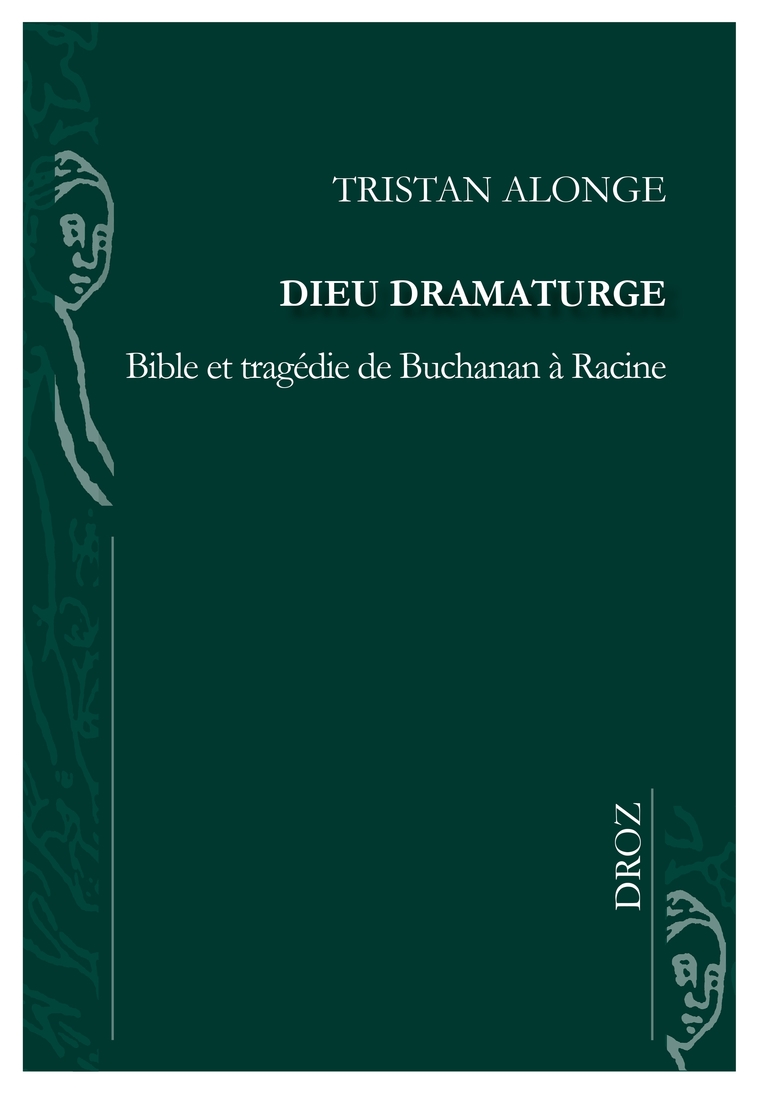
Un paradoxe étonnant caractérise les débuts du théâtre français : alors même que la Bible constitue l’une, sinon la principale source du théâtre sérieux aux XVIe et XVIIe siècles, rares sont les dramaturges bibliques qui sont parvenus à s’assurer quelques lignes dans les manuels de littérature (La Taille, Garnier, Montchrestien, Du Ryer et Racine). L’explication de ce décalage a été donnée depuis longtemps : tragédie et Bible ne seraient tout simplement pas compatibles en raison d’une différence théologique incontournable, la première se fondant sur la confrontation entre l’homme et un destin incompréhensible, la seconde reposant sur une alliance nouée entre la créature et le Créateur, Dieu de justice et de miséricorde.
Prenant résolument le parti de la Littérature et non celui de l’Histoire, de l’interprétation dramaturgique des textes et non de leur contextualisation, le présent ouvrage se propose de redécouvrir cet ensemble disparate de fragments oubliés de l’histoire théâtrale, à la recherche d’une tragédie véritablement biblique et des preuves qu’une rencontre, sous une forme ou sous une autre, a bien eu lieu dans l’atelier de travail de certains dramaturges, démentant ainsi toute prétendue incompatibilité entre Bible et tragédie.
-
-
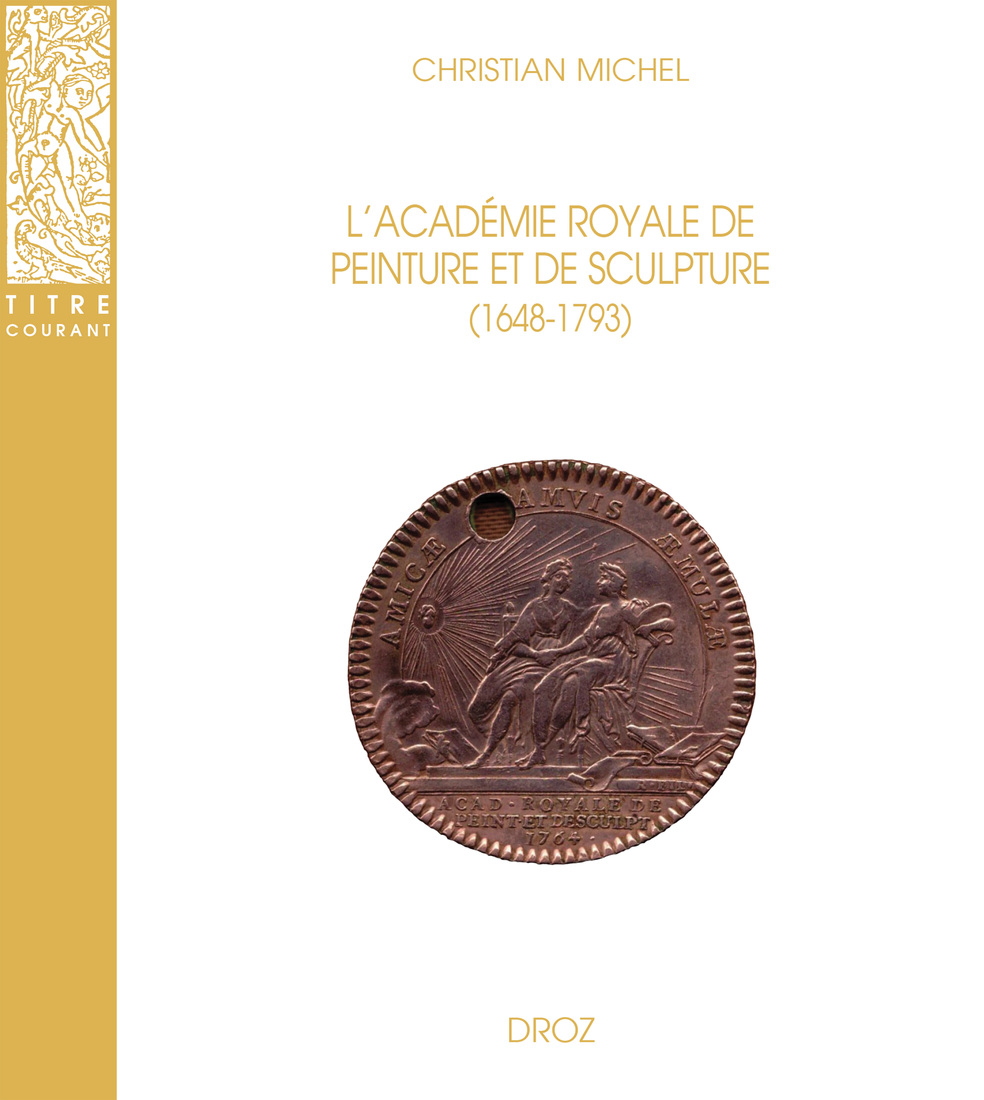
L’Académie royale de Peinture et de Sculpture a régi les arts en France pendant un siècle et demi. Or l’institution demeure largement méconnue et continue d’être présentée aujourd’hui encore en fonction des discours, élogieux ou critiques, qui ont été portés sur elle, tant durant son existence que depuis sa suppression.
Christian Michel fait son histoire et en retrace l’évolution à l’aune des rapports de pouvoir et des querelles de goût qui agitèrent la société française entre 1648 et 1793. Une histoire de l’Académie permet en effet d’apprécier la définition de l’art qu’elle mit en œuvre sous l’Ancien Régime. Sont successivement étudiés les conditions de sélection de ses membres, la façon dont elle construisit sa réflexion sur l’art et comment elle enseigna celui-ci, la fonction des Salons, l’élaboration des critères de fabrication pour qu’une pièce, d’objet manufacturé, pût être élevée au statut d’œuvre d’art, les effets économiques et sociaux qu’eut, pour les artistes, l’appartenance au corps et, enfin, la place que l’Académie tint dans le système des arts en France et en Europe.
Si l’histoire sociale et politique est interrogée par ce livre, son principal enjeu relève de l’histoire de l’art : il entend montrer comment la production artistique a été marquée par l’Académie.
-
Avant-propos
Gaëlle ARPIN-GONNET et Jean-Pierre WARNIER,
Introduction. Lucinge en sa retraite: doutes et écriture
Cédric MOTTIER,
Vivre après le traité de Lyon, ou le prix de la paix
Laurent D'AGOSTINO Évelyne CHAUVIN-DESFLEURS,
Le refuge de l'écrivain: restitution archéologique du château des Allymes
Volker MECKING,
Les trésors d'écriture de Lucinge
Gaëlle ARPIN-GONNET,
Du visage de l'Ambassadeur à la figure du Prince: de la raison d'État à la raison de l'État
Jessie DUVAL,
Comment préserver l'État du déclin et de la chute
Montserrat PERRET,
Le Missel de Lucinge et le chemin vers l'humilité
Emmenuel COUX,
Contextes et conséquences du traité de Lyon
Guy DE BRANTES,
Postface. Gaspard de Coligny (1519-1572) et René de Lucinge (1553-1624): une chronique familiale
Bibliographie générale
Les auteurs
Index
En 1601, René de Lucinge (1553-1624), ambassadeur du duché de Savoie auprès de la cour de France, prit sur lui de parapher le traité de Lyon, par lequel les pays de l’Ain furent donnés au royaume en échange du marquisat de Saluces, proche de Turin, la capitale du duché. Le duc ne le lui pardonna pas. Disgracié, René de Lucinge passa le reste de sa vie dans la solitude, la gêne et l’écriture en son château des Allymes et à Ambérieu. C’est aux années de retraite forcée de ce diplomate clairvoyant, théoricien subtil de la rationalité étatique et homme de lettres servi par une plume superbe, que sont consacrées les interventions rassemblées dans ce recueil, à l’occasion du quadricentenaire de sa mort.
-
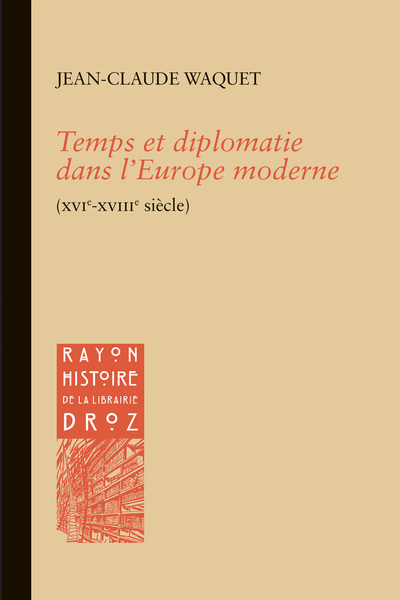
TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos
Introduction
PREMIÈRE PARTIE:
LA DIPLOMATIE EN SON TEMPS
Chapitre premier.
Comment on écrira l'histoire du temps de la diplomatie
Les sources et leur apport
Les temps de l'histoire du temps
Le temps de la bibliographie
Les temps des « International Relations » et des « Negotiation Studies »
Du particulier au général
Les termes de l'enquête
Chapitre II.
Temporalités hétérogènes et présents inattendus
La temporalité de la diplomatie:
Complexité et conflit
Perméabilité et hétérogénéité
Le présent de la diplomatie
Inattendu, incertitude, précarité
La marge de manoeuvre temporelle des acteurs
Chapitre III.
Puissance, Confiance, Prudence : les négociateurs à l'épreuve des temps
Temporalités des négociations et marge de manoeuvre des acteurs : les marchandages entre Florence et Vienne
L'arme des faibles
Le triomphe des forts
Confiance dans le futur et maîtrise des temps : la France et l'Espagne face aux négociations, de la paix de Cateau-Cambrésis à la guerre de Trente ans
Le mirage de la prudence : La Chétardie et les révolutions de Saint-Pétersbourg
Manipulation des temps et construction de l'événement
Manipulation narrative et reconstruction de l'événement
DEUXIÈME PARTIE:
LE TEMPS DE L'AMBASSADEUR GUILLERAGUES
Chapitre IV.
Philarque chez les Turcs
De Bordeaux à Constantinople : la réussite, mais à crédit
L'Empire ottoman : altérité, commensurabilité, opportunités
Une ambassade au croisement des espaces-temps
Les lettres sérieuses d'un mondain devenu ambassadeur
Chapitre V.
Naviguer entre les temps : la temporalité de l'ambasadeur Guilleragues
La pluralité des temps
L'enchevêtrement des temps
Chapitre VI.
Voir le futur : des nouvelles aux pronostics
Des nouvelles du futur
Les fondements de l'interprétation
La fabrique des apparences
D'une apparence à l'autre : l'histoire devant soi
Un futur sans avenir ni intrigue
Chapitre VII.
Agir selon l'à-propos. I. La production du futur
Un préalable : les conditions d'exercice de l'à-propos
Le temps des échanges et les débuts difficiles de l'affaire du sofa
Reprendre la maîtrise du temps : le levier du futur et l'épreuve du présent
Le bombardement de Chio : de la préemption de l'avenir à la recomposition de la temporalité
Réécriture des futurs, croissance des risques et reclassement des temps
L'impossible maîtrise des temps des affaires
La marge de manoeuvre temporelle et ses risques
Après Chio : le temps du patronage, menacé et sauvé
La maîtrise perdue, puis retrouvée, du temps de l'affaire du sofa
Remarques finales
La conquête du futur et les épreuves du présent
Une pratique conflictuelle des temps
Chapitre VIII.
Agir selon l'à-propos. 2. La production du passé
Août 1681 : le récit crée l'événement
Les négociations d'octobre : le temps du récit au service de l'apologie et de la justification
Les variations du temps raconté
Du récit apologétique au récit glorieux
Amis et ennemis
La conclusion de l'affaire de Chio et la relance de la compétition narrative
Conclusion
Souci du futur et histoire devant soi : l'expérience temporelle des négociateurs
Entre imaginaire, expérience et figuration : les trois faces du Temps de l'ambassadeur Guilleragues
Sources et Bibliographie
Sources manuscrites et imprimées
Bibliographie
Index des noms de personnes
Index des noms de lieux
L’histoire du Temps de la diplomatie à l’époque moderne est celle de l’enchevêtrement de ses praticiens dans un dédale de temps désaccordés dont l’horloge, symbole de la modernité, n’était pas le grand régulateur. Elle montre comment ces personnages anxieux de percer l’opacité du futur, familiers des pronostics, mais aussi exposés au dévoilement de l’histoire, faisaient des temps, manipulés ou racontés, une ressource de leur action et l’un des moyens de réaliser leurs fins. Son objet est ainsi l’être au temps et le faire avec les temps de ceux qui étaient dépêchés au loin, et spécialement de Guilleragues, ambassadeur de Louis XIV à Constantinople, qui tient ici le rôle principal. À travers lui et quelques autres, l’univers temporel des acteurs de la diplomatie se trouve restitué, et la diplomatie de l’âge moderne revisitée à partir d’une de ses dimensions les plus essentielles, négligée jusqu’à présent par l’historiographie.
-
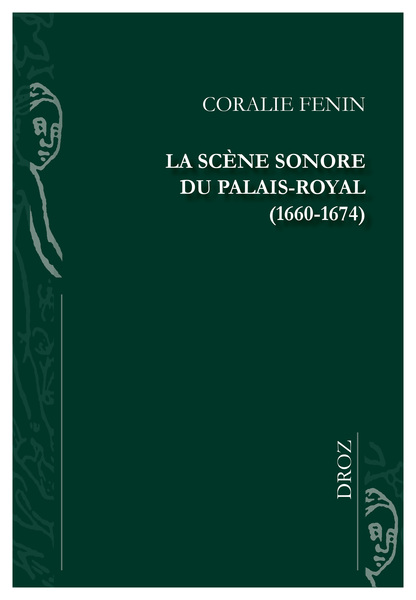
Le théâtre du Palais-Royal des années 1660 ancre dans la mémoire collective des figures archétypales et des pratiques promises à une prodigieuse renommée. Domenico Biancolelli, le plus célèbre des Arlequin, ou Tiberio Fiorilli, le talentueux Scaramouche, se produisent sur ses planches tandis que Molière, parangon des auteurs classiques, y crée des chefs-d’œuvre qui attirent la Ville et la Cour. Dans ce lieu unique, le spectacle est littéralement inouï : les comédiens jouent en français ou en italien des pièces mêlées de musique, ils se spécialisent dans le jeu des pleurs ou dans celui des rires, ils expérimentent une diction nouvelle, ils chantent. Dans une perspective pluridisciplinaire, inspirée de l’histoire des sensibilités, cet ouvrage étudie l’acoustique de la salle du Palais-Royal, les sons de la scène et la voix du public afin de reconstituer l’éphémère et fugitive ambiance sonore d’une séance théâtrale de la seconde moitié du XVIIe siècle. Il montre comment le texte théâtral programme son écoute, il explore la rhétorique mobilisée par les spectateurs pour rendre compte de leur expérience auditive et exhume des jeux de scène insoupçonnés. De l’oubli surgissent alors des voix que l’on croyait à jamais éteintes.
-

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION, par Yasmine ATLAS, Adrien MANGILI et
Dorine ROUILLER
PREMIÈRE PARTIE
CONTRAINTES ET MISES EN ORDRE
Isabelle PANTIN, Les catalogues de livres et la question des
frontières disciplinaires au début de l'époque moderne
Raphaël SANDOZ, Comment retracer la mutation des frontières
disciplinaires ? Éléments d'une cartographie historique
des savoirs
Anne-Marie CHENY, Collecter, classer, nommer. Nicolas-
Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) et la naissance des
études byzantines
Violaine GIACOMOTTO-CHARRA, Le vulgarisateur à
l'oeuvre, ou l'encyclopédie bien ordonnée. L'exemple de
Scipion Dupleix
DEUXIÈME PARTIE
AFFIRMATIONS
Oury GOLDMAN, Les savoirs géographiques dans les Bibliotheque
française de Du Verdier et de La Croix Du Maine.
Recenser, vulgariser et intégrer un domaine savant en
Construction
Grégoire HOLTZ, Affirmer le point de vue du voyageur. La
contribution des traités sur la perspective
Antoine GALLAY, Un nouveau regard sur la nature ? La
professionnalisation des dessinateurs de l'Académie
royale des sciences et la transformation des modes de
représentation en histoire naturelle à la fin du
XVIIe siècle
Philippe GLARDON, Déclinaisons et évolution de l'instance
auctoriale dans les traités d'histoire naturelle au
XVIe siècle. Pistes de réflexion
TROISIÈME PARTIE
RÉSISTANCES ET NÉGOCIATIONS
Myriam MARRACHE-GOURAUD, Pour une éthique de la
curiosité. Le savoir aux lisières de l'émerveillement dans
le Cabinet de la Bibliothèque Sainte-Geneviève
Adrien MANGILI, « Non plus ultra » ? La magie naturelle
comme frontière mouvante des savoirs
Dorine ROUILLER, Franchissement géographique et passages
épistémiques. La zone torride en question à la
Renaissance
Nicolas CORREARD, Astro-satiro-logie. Pronostications
parodiques, polémiques savantes, redéfinitions épistémologiques
QUATRIÈME PARTIE
HYBRIDATIONS
Jean-Marc BESSE, Entre le paysage et l'atlas. Les enjeux de
l'iconographie urbaine dans le voyage en Italie de Joris
Hoefnagel et Abraham Ortelius
Fabrice FLÜCKIGER, Le Monde de la Vierge. L'Atlas Marianus
de Wilhelm Gumppenberg à la frontière entre culte
des images et démonstration savante
Thibaut MAUS DE ROLLEY, Des foires aux salons. La littérature
technique sur le batelage aux XVIe et XVIIe siècles
Jörg DÜNNE, Quasi-sujets sur la route des Indes. Savoir
nautique et protagonisme du navire dans deux « memórias
das armadas » portugaises
RÉSUMÉS DES CHAPITRES
INDEX NOMINUM
Pour qui s’intéresse à la constitution des savoirs, la production intellectuelle de la première modernité représente un terrain d’investigation stimulant, tant elle résiste à une réduction stricte aux catégories scientifiques actuelles. Or, constater la perméabilité des domaines du savoir comme les affinités des savants avec ce qui semble aujourd’hui relever de la croyance, sinon de la superstition, ne revient pas à affirmer l’absence de toute délimitation ni de toute logique. Entre l’abandon progressif des pratiques culturelles propres à l’encyclopédisme humaniste et les configurations nouvelles qu’institutionnalisent les sociétés savantes dans le second XVIIe siècle, le partage des savoirs fait l’objet d’incessantes négociations. Ce volume explore les dynamiques à l’œuvre dans les lieux, livresques comme institutionnels, où se font et se défont les frontières épistémiques. Choix éditoriaux, rhétorique des textes ou des images, inventaires de bibliothèque et catalogues de libraire renouvelleront ici notre regard sur les facteurs qui ont pu, dans leur diversité de nature et d’échelle, intervenir dans la (re)configuration des catégories du savoir.
-

TABLE DES MATIÈRES
Antoine COMPAGNON, de l’Académie française, Collège de France
Préface
Première partie
Au Collège de France
Françoise GRAZIANI, université de Corse Pasquale Paoli
La sagesse des Anciens
Patrick DANDREY, Sorbonne Université
Marc Fumaroli, lecteur de La Fontaine
Lina BOLZONI, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (correspondant étranger), École normale supérieure de Pise
Fumaroli, ou la renaissance de la rhétorique
Florence VUILLEUMIER LAURENS, université de Brest
Respublica romana, christiana, literaria
Jean-Robert ARMOGATHE, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
L’art de se taire
Deuxième partie
Textes d’hommage
Mireille HUCHON, Sorbonne Université
Jean-Luc MARION, de l’Académie française
Pierre NORA, de l’Académie française
Hommage à Marc Fumaroli
Laurent PERNOT, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, université de Strasbourg
Marc Fumaroli, les Anciens et la rhétorique
Jean-Claude CASANOVA, de l’Académie des sciences morales et politiques
Hommage à Marc
Troisième partie
Au musée du Louvre
Pierre CAYE, CNRS
Pour un autre xviiie siècle. Marc Fumaroli, penseur des Lumières
Frédéric COUSINIÉ, université de Rouen
Pour une théorhétorique du corps ascensionnel : autourde Simon Vouet
Stéphane GUÉGAN, musée d’Orsay
Manet rocaille
Olga MEDVEDKOVA, CNRS
Marc Fumaroli et l’héritage d’Aby Warburg
Nicolas MILOVANOVIC, musée du Louvre
Fumaroli et Poussin
Darius A. SPIETH, Louisiana State University
Esprit de modernité et art moderne dans la vie et l’oeuvrede Marc Fumaroli
Index nominum
De L’Âge de l’éloquence à L’École du silence, de La République des Lettres à Paris-New York et retour, Marc Fumaroli (1932-2020), de l’Académie française, a laissé un héritage intellectuel considérable dans les études d’histoire littéraire et d’histoire de l’art. Titulaire de la chaire Rhétorique et société en Europe, xvie-xviie siècles, de 1987 à 2002 au Collège de France, il fut également pendant deux décennies président de la Société des amis du Louvre (1996-2016). Cet ouvrage, dirigé par Antoine Compagnon et issu de deux journées de colloque qui s’étaient tenues au Collège de France et au musée du Louvre en 2021, montre toute l’actualité de l’œuvre de Marc Fumaroli dans la littérature, les arts et la politique culturelle. Les contributions de celles et ceux qui ont travaillé de près avec Marc Fumaroli nous invitent à relire ce grand historien de la littérature, au sens large de la Res literaria et de la Respublica literaria, l’amicale européenne des savants, qui a toujours défendu l’Europe des lettres et des arts, mais aussi des idées et des formes.
-

TABLE DES MATIÈRES
Remerciements
Avertissement
Abréviations
Introduction
Typologies et études de cas
Les pièces d’apparat et les résidences : modèles artistiques, modèles politiques ?
Vers une approche comparative européenne de l’escalier d’honneur
Première partie
UTILITÉ ET SPLENDEUR
Chapitre premier
Les fonctions de l’escalier d’honneur
L’accès principal à l’appartement du prince
Les pièces desservies par l’escalier d’honneur
Le placement de l’escalier d’honneur et sa visibilité
Forme des rampes et distribution
Un lieu clé du cérémonial européen
Entrées princières, audiences, fêtes et divertissements
Un accès réglementé au quotidien
Chapitre II
L’escalier d’honneur et les contraintes des bâtiments princiers
La typologie complexe des édifices princiers
Des appellations aux contours flous
L’appropriation d’un édifice : des changements de statut et d’usages d’un souverain à l’autre
Anciens et nouveaux bâtiments
Incarner le passé dynastique
L’escalier d’honneur, une pièce importante dans les nouveaux édifices
Deuxième partie
L’ESCALIER D’HONNEUR ET LA MAGNIFICENCE PRINCIÈRE
Chapitre III
Dépense, noblesse des matériaux et convenance
Des chantiers longs et coûteux
Origines et modalités de financement
La répartition du coût des escaliers entre le gros œuvre et la décoration
L’approvisionnement des matériaux
Entre ressources naturelles du territoire et importations : marbre, pierre, stucs
Le problème des marches
Une splendeur convenable : la gradation de l’effet de richesse dans l’appartement princier
Peinture et sculpture
Architecture feinte et quadrature : l’illusion de l’espace
Chapitre IV
Des sujets dignes d’un prince : les choix iconographiques et leurs enjeux
L’universalité de la fable et de l’allégorie : convenance et allusions politiques
Le règne d’Apollon et l’assemblée des dieux : des thèmes privilégiés de la Fable autour de 1700
L’Énée bavarois et les ambitions impériales des Wittelsbach dans les années 1720
Les amours d’Alexandre dans l’escalier de Fontainebleau au lendemain de la guerre de succession d’Autriche
L’allégorie comme élément de distinction
Représenter l’histoire d’un règne ou d’un État : l’apanage de la souveraineté
Versailles et Madrid : continuités et ruptures dynastiques
Une souveraineté éphémère : les princes ecclésiastiques germaniques et le modèle iconographique royal
Le portrait du prince pour accueillir le visiteur : entre dimension mémorielle et magnificence
Portraits de rois
La singularité de l’Empire
Troisième partie
PERSPECTIVES DYNASTIQUES : ÉCHANGES, ADAPTATIONS ET APPROPRIATIONS FAMILIALES
Chapitre V
Les escaliers des Wittelsbach : la constitution d’un modèle dynastique ?
Max Emanuel et Joseph Clemens de Bavière : deux frères bâtisseurs
Avant l’exil, un architecte en commun : Henrico Zuccalli
Le retour d’exil et la concrétisation des projets
Schleissheim : une référence familiale dans les années 1720
Les escaliers de la résidence de Munich et du château de Brühl
La branche du Palatinat : l’électeur Karl Philipp et l’escalier de la résidence de Mannheim
Chapitre VI
Les escaliers des Schönborn : des enjeux diplomatiques
Lothar Franz von Schönborn, Leonhardt Dientzenhofer et les premiers escaliers des Schönborn
Autour de 1700 : les premiers essais à Bamberg et Gaibach
L’invention de l’escalier du château Weissenstein à Pommersfelden dans la décennie 1710
Les escaliers de Balthasar Neumann pour les neveux de Lothar Franz (vers 1730-vers 1750)
Würzburg : la reconnaissance des compétences de Balthasar Neumann et l’expression de la réussite familiale
Les escaliers de Balthasar Neumann au service des ambitions diplomatiques des Schönborn
Chapitre VII
Les escaliers des Bourbons d’Espagne : une recherche de variété
Les escaliers d’Aranjuez et de Riofrío sous Philippe V et Ferdinand VI : l’adaptation de projets non exécutés pour le palais royal
Aranjuez, de Carlo Pedro Idrogo à Santiago Bonavia : un changement radical
L’escalier du Riofrío : une alternative à l’escalier du palais royal
De l’Italie à l’Espagne : l’escalier selon Charles III
Luigi Vanvitelli et le succès de Caserte : la genèse d’un escalier royal
Un architecte de Caserte à Madrid : Francesco Sabatini
Quatrième partie
CIRCULATION, ÉMULATION ET LÉGITIMATION
Chapitre VIII
L’escalier dans la culture architecturale européenne
L’expérience in situ
Le regard critique de l’architecte
Transmettre et rendre compte
À l’italienne, à la française
La spécificité du regard germanique
Les autres pays européens
La constitution d’une théorie de l’escalier
De l’Italie à la France
L’escalier dans les écrits en langue allemande : le rôle fondamental de Leonhard Christoph Sturm
Chapitre IX
L’escalier gravé : une diffusion ciblée
Les vues gravées en perspective : rendre les effets de volume de la cage d’escalier
Dessiner et graver des vues d’architecture : deux compétences distinctes
Mettre en perspective une cage d’escalier : point de vue et ligne d’horizon
L’importance des figures
Plans et coupes : diffuser le projet architectural
L’escalier du château de Berlin gravé par Jean-Baptiste Broebes
Le projet du palais de Caserte gravé sous la conduite de Luigi Vanvitelli
Le décor par parties
Plafonds peints
Figures isolées
Chapitre X
Paris et Rome : Des instances de conseil et de légitimation
Robert de Cotte : les conseils du premier architecte du roi de France
Balthasar Neumann à Paris
De la Bavière à l’Espagne
L’envoi des projets de l’escalier du palais royal de Madrid à l’Académie de Saint-Luc à Rome
Le modèle italien et l’Espagne des Bourbons : entre nécessité et magnificence
Annibale Scotti et la naissance d’un débat
Les conséquences de la consultation de l’Académie romaine
Conclusion
La splendeur de Versailles : un tournant de la dynamique somptuaire en Europe
Accueillir dignement et se distinguer
ANNEXES
ANNEXE I
Notices sommaires des principaux escaliers analysés
[E.1] Versailles, château de Versailles (Royaume de France)
[E.2] Londres, Kensington Palace (Royaume d’Angleterre)
[E.3] Dresde, Résidence de (Saint-Empire romain germanique, Électorat de Saxe)
[E.4] Londres (Molesey), Palais de Hampton Court (Royaume d’Angleterre)
[E.5] Schleissheim, Château neuf de (Saint‑Empire romain germanique, Électorat de Bavière)
[E.6] Berlin, Château de (Saint-Empire romain germanique, Royaume de Prusse)
[E.7] Pommersfelden, château Weissenstein (territoire indépendant appartenant aux Schönborn)
[E.8] Dachau, Château de (Saint-Empire romain germanique, Électorat de Bavière)
[E.9] Bonn, Résidence de (Saint-Empire romain germanique, Électorat de Cologne)
[E.10] Brühl, Château d’Augustusburg (Saint‑Empire romain germanique, Électorat de Cologne)
[E.11] Mannheim, Château de (Saint-Empire romain germanique, Électorat Palatin)
[E.12] Aranjuez, Palais d’ (Royaume d’Espagne)
[E.13] Ludwigsburg, Château de (Saint-Empire romain germanique, Duché de Wurtemberg)
[E.14] Munich, Résidence de (Saint‑Empire romain germanique, Électorat de Bavière)
[E.15] Bruchsal, Résidence de (Saint‑Empire romain germanique, principauté épiscopale de Spire)
[E.16] Madrid, Nouveau palais royal de (Royaume d’Espagne)
[E.17] Würzburg, Résidence de (Saint‑Empire romain germanique, principauté épiscopale de Würzburg)
[E.18] Charlottenburg, Château de (Saint-Empire romain germanique, Royaume de Prusse)
[E.19] Vienne, Château de Schönbrunn (Saint‑Empire romain germanique, Cour impériale)
[E.20] Potsdam, Stadtschloss (Saint-Empire romain germanique, Royaume de Prusse)
[E.21] Vienne, Hofburg (Saint-Empire romain germanique, Cour impériale)
[E.22] Fontainebleau, château de (Royaume de France)
[E.23] Caserte, Palais de (Royaume de Naples)
ANNEXE II
Sources comptables
Sources et bibliographie
Sources manuscrites
Allemagne
Autriche
Espagne
France
Italie
Royaume-Uni
Sources imprimées
Ouvrages
Périodiques
Bibliographie
Index des noms
Index des lieux
Table des illustrations
Entre les années 1670 et 1760, les grands escaliers d’honneurs devinrent un espace d’apparat privilégié au sein des résidences princières européennes. Ils incarnaient à la fois le rang et les ambitions de leurs commanditaires. De Versailles à Caserta, de nombreux chantiers furent entrepris, dans un contexte diplomatique marqué par les rééquilibres politiques entraînés par la montée en puissance de la France de Louis XIV puis les guerres de succession d’Espagne (1701-1713), de Pologne (1733-1738) et d’Autriche (1740-1748). À partir d’un corpus original d’une trentaine d’escaliers bâtis pour des princes souverains en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en France et surtout dans le Saint-Empire romain germanique, cet ouvrage vise à mieux comprendre les contraintes et les enjeux qui ont présidé à leur production, en se fondant sur des sources en partie inédites. Pour la première fois, l’escalier est abordé tant sur le plan de l’architecture que du décor dans une perspective européenne qui donne un éclairage nouveau sur la compétition somptuaire entre les cours à l’époque moderne.
-

TABLE DES MATIÈRES
Préface
Introduction
PREMIÈRE PARTIE : INVENTIO : LA « SUITE » ET SA MATIÈRE
Chapitre premier : LES GENÈSES DE LA RÉPÉTITION
I. La mémoire des formes
Suites de fourberies
Suites de méprises
De la suite à la répétition : l’invention de la séquence
II. L’inventio par duplication : faire beaucoup de peu
1 Barbouillé · 3 = 1 Dandin
Amphitryon, ou la mythologie dupliquée
Un assèchement de l’inventio : une copia comique facilitée ?
III. L’inventio par sélection : la comédie au filtre de l’identité
Séries volées : les Ecole
La sélection par l’identité : L’Etourdi
Deux méthodes inverses
Chapitre II : L’« ÉGALITÉ » ABSOLUE, OU LE FANTASME DU PERSONNAGE RÉPÉTITIF
I. Une règle, enfin, pour la comédie
Arnolphe, nouvelle Chimène
Une règle spécifique à la comédie
Une règle unique : « soutenir son caractère »
De l’égalité à la répétition : le piège des caractérisations multiples
II. Qu’est-ce que la comédie de caractère ?
« Molière a tout donné aux caractères »
La caractérisation répétitive
III. Les deux espèces de la comédie de caractère
Première espèce : la mise en action d’un « ridicule »
Deuxième espèce : le personnage comme « suite »
IV. Caractères longs, caractères courts : la copia du caractère
Réduire le caractère
Déduire le caractère ? Personnage et duplication
Problèmes dramaturgiques de la comédie de mœurs
Chapitre III : LA RÉCEPTION DE LA SUITE : THÈME, VARIATION, RÉFÉRENCE
I. Référence / non-référence
II. Réception active / Réception passive
Chapitre IV : RHÉTORIQUE SÉRIELLE
I. L’exemplification sérielle
Le principe des déboires instructifs
Les exemples parallèles
Comédie de caractère et exemplification sérielle
II. Procédures herméneutiques
Comparaison signifiante
Equivalences formelles, équivalences sémantiques
SECONDE PARTIE : DISPOSITIO : LA MISE EN INTRIGUE DE LA SUITE
Chapitre premier : LA CONDUITE DU SUJET RÉPÉTITIF
I. La pièce à principe
Le valet et la répétition : d’un très ancien problème de motivation
Le « principe » de « ressemblance surnaturelle » : le cas Amphitryon
Deux manières de « conduire » le sujet répétitif
II. La pièce à relance
La querelle de la répétition : logique sérielle et logique dramatique
Instrumentalisation du dramatique et dysfonctionnements
Chapitre II : CONDUIRE LE CARACTÈRE : « MULTIPLIER LES TRAITS AVEC ART »
I. Conduire le caractère trait par trait
Le personnage aiguillon
L’universel complot
Le caractère opposant, ou la conduite au trait par trait généralisée
II. Régler globalement la conduite du caractère
Le projet consonant et le risque de l’« effet pamphlet »
Le projet dissonant
Chapitre III : ENJEUX ESTHÉTIQUES DE LA CONDUITE
I. Conduite et comique
II. Conduite, artifice, beauté
Chapitre IV : LIQUIDER LA SÉRIE : DE L’ART DE FINIR, OU DE NE PAS FINIR
I. L’art de ne pas dénouer trop vite : donner du temps à la « suite »
Dramaturgie de la tentative
Dramaturgie de l’action annulée
Dramaturgie implexe
Exceptions : dénouer grâce à la répétition (non ad lib)
II. L’art de dénouer en force : liquider la suite
Le renoncement au dénouement heureux
Le déplacement de l’inconstance
L’intrigue implexe
Dénouer par le carnaval
Chapitre V : NOUVELLES COHÉRENCES
I. La comédie au risque du comique : le principe de détour
II. La répétition et l’effet de cohérence
Cohérence effective, cohérence surjouée
Simplification de la cohérence et simplification de la disposition
III. La comédie répétitive et la question de l’ordre
Principes de variation
Gradation
Un succédané de causalité
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
I. Éditions des œuvres de Molière utilisées
II. Usuels et outils du moliériste
III. Œuvres littéraires
IV. Critique ancienne
V. Études modernes sur Molière
VI. Critique moderne
INDEX
TABLE DES MATIÈRES
Genre dramatique pour lequel les catégories classiques de la poétique sont inadaptées, la comédie a été perçue par une longue tradition critique comme un art relevant « purement du génie », sans règle ni méthode. Afin d’y apporter un brillant démenti, cet essai dégage les principales techniques de composition et les modes de fonctionnement des comédies de Molière. Au cœur de l’âge classique, celui-ci invente une manière de structurer la fiction qui rompt avec les fondements mêmes de la poétique aristotélicienne. Selon Jean de Guardia, c’est la notion de répétition qui se trouve au centre de ce dispositif. Le procédé stylistique n’est en effet chez Molière que la partie apparente d’un système d’écriture plus général, qui concerne tous les éléments de la dramaturgie, et notamment les grandes structures de la fable comique. Dès lors, le principe du théâtre ne consiste plus à engendrer de la différence (et, ce faisant, l’attente permanente du spectateur) par l’enchaînement nécessaire ou vraisemblable des événements, mais bien à créer de la similarité (c’est-à-dire la reconnaissance permanente) au moyen de la répétition.